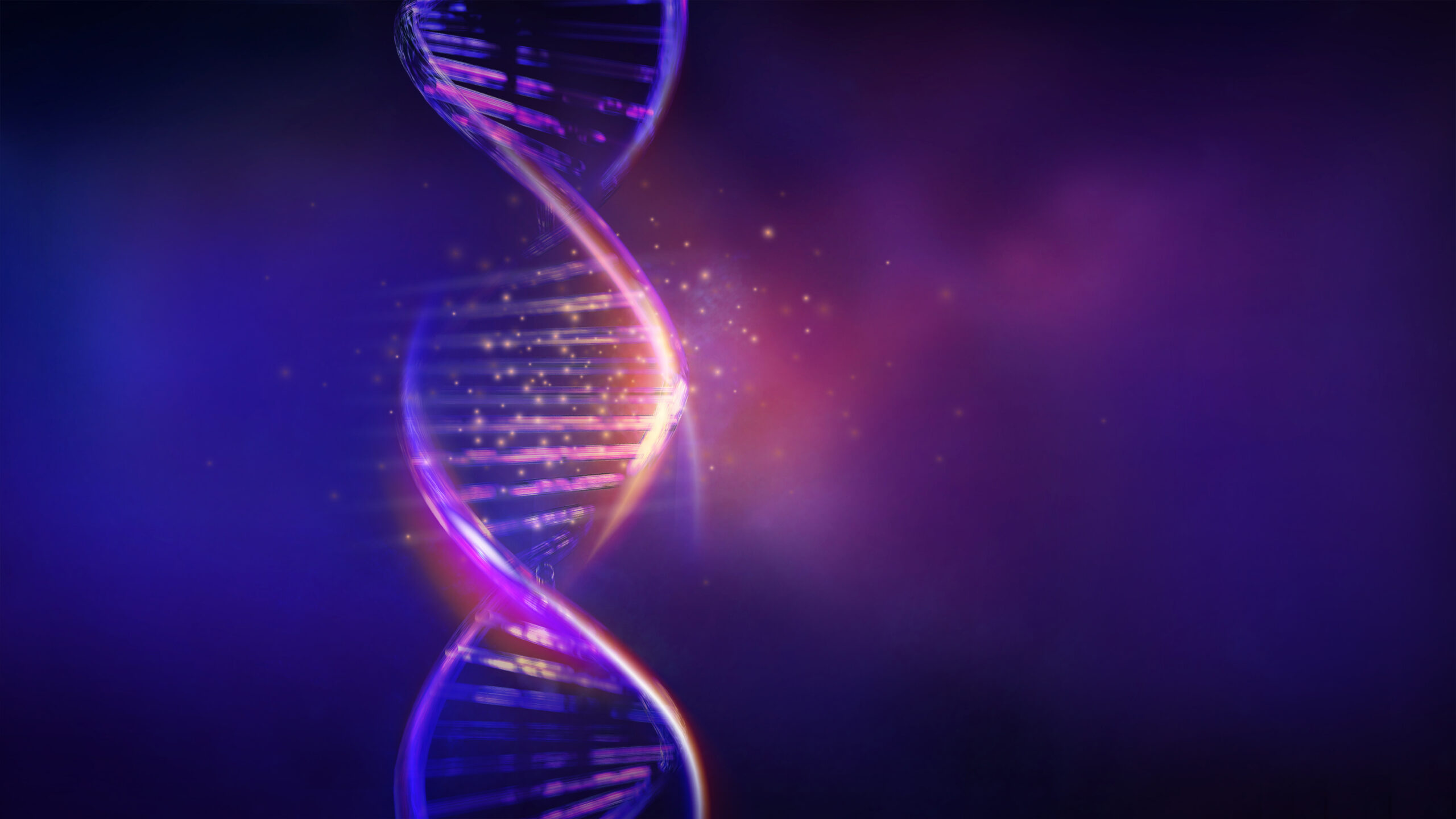La biologie moderne n’apporte pas seulement de nouvelles connaissances sur la génomique. A minima, ne devrait-elle pas nous interroger sur nos responsabilités face à ses avancées ?
Prise de conscience sur les nouvelles responsabilités qui s’imposent à nous.
La génomique de l’ancestralité, l’épigénomique environnementale ou encore l’étude de l’ADN ancien bouleversent désormais la manière même dont nous pensons notre identité. Et elles interrogent directement quant à la prise de conscience sur les nouvelles responsabilités qui s’imposent à nous.
C’est en substance le thème d’un article passionnant de Francois Romijn, ancien chargé de recherches au F.R.S.-FNRS au Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC) de l’Université Libre de Bruxelles, publié en 2023 et intitulé : « Nouveaux savoirs spécialisés sur le biologique et redéfinitions de la responsabilité : génomique de l’ancestralité, épigénomique environnementale et ADN ancien. »
Entre tests ADN grand public dits « récréatifs » (interdits en France mais qui rencontrent un énorme succès sur les réseaux sociaux), recherches en épigénétique et analyses d’ADN ancien, la science redessine aujourd’hui les frontières de l’héritage génomique et de sa perception par les individus.
La génomique de l’ancestralité questionne notre rapport à nos origines. L’épigénomique environnementale révèle l’empreinte laissée par les traumatismes passés et l’environnement sur les générations futures. La paléogénomique éclaire quant à elle, entre autres, la diversité et les migrations humaines à travers les millénaires.
Ces savoirs ouvrent un débat inédit : sommes-nous définis par nos gènes, nos environnements ou nos choix ? Et comment la société, devant les progrès de la biologie moderne, doit-elle repenser les responsabilités, individuelles et collectives, en regard des données génomiques ? Depuis le grand public, qui est invité à prendre conscience de l’importance cruciale des donnés génomiques, jusqu’au législateur, en passant évidemment par le scientifique.
Et c’est justement à ce triple enjeu scientifique, étique et sociétal que l’innovation révolutionnaire de GENARO vient apporter des solutions concrètes.
L’article complet est à retrouver sur https://journals.openedition.org/sociologies/22118
Abstract :
S’appuyant sur des travaux menés ces dernières années, ce texte prolonge des réflexions présentes dans l’œuvre de Jean-Louis Genard – sur les redéfinitions du rapport à la responsabilité – dans des domaines de pratiques où le biologique véhicule des interprétants qui résistent à celui de la responsabilité moderne. À l’appui de trois types de savoirs spécialisés, distincts, mais tous trois de plus en plus accessibles au grand public – la génomique de l’ancestralité, l’épigénomique environnementale et la paléogénomique humaine – des acteurs sociaux formulent des récits qui articulent sur le plan discursif des résultats d’analyses génomiques et des récits identitaires, des temporalités singulières qui connectent passé et présent, et établissent des connexions entre soi et autrui. Au travers de ces récits, de nouvelles formes de rapport à la responsabilité et à la construction des identités semblent émerger. Celles-ci sont particulièrement bien mises en lumière par les outils et réflexions menées par Jean-Louis Genard.